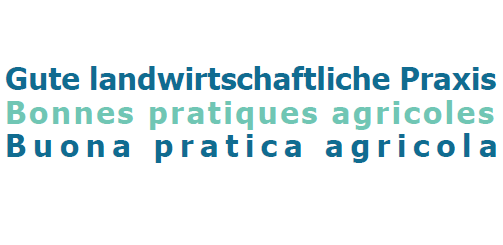Conclusion de l’étude d’Agroscope: l’initiative sur l’eau potable diminuerait encore plus la production alimentaire dans notre pays

Aujourd’hui déjà, la Suisse produit moins de la moitié des denrées alimentaires qu’elle consomme. Les effets drastiques de l’initiative populaire concernant l’eau potable réduiraient encore plus la productivité intérieure et stimuleraient d’autant les importations d’aliments.
L’initiative sur l’eau potable veut supprimer les paiements directs aux agriculteurs qui utilisent des pesticides et ne respectent pas un certain nombre de conditions draconiennes concernant la production de fourrage et l’utilisation d’antibiotiques pour les animaux d’élevage. Elle aurait un impact considérable sur l’agriculture. Toutes les exploitations ne seraient pas en mesure de satisfaire à ces conditions rigoureuses. Certaines se retireraient donc du système des paiements directs et pourraient alors travailler sur la base de normes environnementales moins strictes. C’est ce qu’une étude de la Haute école des sciences agronomiques (BFH-HAFL), a déjà démontré en mai de cette année, après une analyse d’exploitations sélectionnées. A présent, la station de recherches agronomiques Agroscope poursuit une étude sur les effets qu’aurait l’initiative Eau potable en 2025 sur l’ensemble du secteur agricole suisse.
De tels calculs reposent toujours sur des hypothèses différentes, par exemple les pertes de rendement escomptées, l’évolution des prix des produits agricoles et une éventuelle redistribution des paiements directs. Comme il est impossible de prévoir avec certitude les développements futurs, l’étude d’Agroscope se fonde sur un total de 18 scénarios différents pour couvrir le plus grand nombre possible de développements potentiels.
Selon les hypothèses retenues il serait économiquement plus intéressant pour 33 à 63 % des exploitations de transformation (élevage de porcs et de volailles) et pour 51 à 93 % des cultivateurs de fruits, de légumes et de baies de se retirer du système des paiements directs et de se lancer à l’avenir dans un mode d’exploitation intensive sans se plier aux exigences écologiques de l’initiative si celle-ci était adoptée. Si les consommateurs étaient prêts, à l’avenir, à payer deux fois plus cher des produits agricoles sans pesticides, l’initiative sur l’eau potable serait également acceptable pour les exploitations n’utilisant pas de produits phytosanitaires. Mais celles-ci devraient s’attendre à des pertes si les consommateurs n’étaient pas disposés à payer autant ou s’ils consommaient davantage de produits meilleur marché venant de l’étranger.
Selon les différents scénarios, 70 à 92% des terres arables ouvertes en Suisse pourraient à l’avenir être cultivées sans produits phytosanitaires. En renonçant à ces produits, il faudrait toutefois s’attendre, dans certains cas, à des pertes de rendement considérables, pouvant atteindre 40 % ou plus pour les céréales et les betteraves sucrières, 50 % ou plus pour les légumes, 60% au minimum pour les fruits et les pommes de terre et jusqu’à 80 % pour les baies et la vigne. Il est donc probable que les exploitants continueront de traiter avec des produits phytosanitaires une grande partie des terres dévolues aujourd’hui aux fruits, aux pommes de terre, aux baies, à la vigne et aux légumes.

L’adoption de l’initiative sur l’eau potable pourrait faire baisser de 20% à 45% la production suisse de pommes de terre.
Les nouvelles conditions imposées par l’initiative changeraient l’affectation des terres. Même sur la base d’hypothèses favorables, la chute des rendements due à l’absence de produits phytosanitaires ferait baisser de respectivement 44% et 22% la production suisse de sucre et d’oléagineux, soit à un niveau trop faible pour justifier les installations de transformation existantes.
L’acceptation de l’initiative impacterait massivement la production alimentaire totale de la Suisse. Selon le scénario considéré, le recul de la production nationale de calories se situerait entre 12 et 21%. Cela ferait tomber le taux brut d’autosuffisance (qui inclut le fourrage importé) de 54% à 11-20%, avec pour corollaire une forte augmentation de notre dépendance à l’égard de la production étrangère et des importations alimentaires bien plus importantes qu’aujourd’hui. Qu’un tel redéploiement de l’approvisionnement alimentaire au profit de l’étranger soit écologiquement judicieux est pour le moins douteux. Le directeur sortant de l’Office fédéral de l’agriculture, Bernhard Lehmann, souligne que de nombreux pays dans le monde ne pourraient pas supporter les conséquences de ce genre d’initiatives. D’où son jugement que celles-ci, à l’échelle planétaire, seraient totalement contraires à l’éthique.
Un volet particulièrement intéressant de l’étude est l’évaluation des résultats par différents groupes d’acteurs. L’Union suisse des paysans est préoccupée par la perspective d’une baisse brutale du degré d’autosuffisance et voit dans l’initiative sur l’eau potable une menace pour la sécurité de l’approvisionnement de la Suisse. D’autres critiques pointent la perte de zones de promotion de la biodiversité, la baisse de qualité des produits et de la sécurité alimentaire, le déclin massif des cultures de betterave sucrière, d’oléagineux, de pommes de terre, de vignes, de fruits, de baies et des légumes et la baisse des revenus agricoles. Pour l’Union suisse des paysans, l’Initiative sur l’eau potable manque clairement sa cible et est contre-productive.
Pro Natura et l’Atelier de réflexion Vision Agriculture, qui souhaitent tous deux réduire massivement le recours aux pesticides, qualifient d’irréalistes les hypothèses de l’étude Agroscope. Selon leur interprétation, tous les pesticides ne sont pas visés par l’initiative sur l’eau potable. D’après eux, les produits admis pour l’agriculture biologique pourront continuer d’être utilisés, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’attendre à des impacts négatifs aussi importants que ceux décrits par l’étude. Lors de la collecte des signatures, cependant, les auteurs de l’initiative avaient clairement dénoncé, en bloc, tous les pesticides et étiqueté comme problématiques également les substances chimiques utilisées dans l’agriculture bio (par exemple les pesticides contenant du cuivre, un métal lourd). Ce n’est qu’après la collecte des signatures qu’ils ont soudain changé d’avis et, dans une démarche douteuse, exclu du champ d’application de l’initiative les pesticides admis pour les cultures bio, afin d’augmenter les chances de succès de leur texte en votation.
Informations complémentaires
- Une étude d’Agroscope évalue les conséquences de l’initiative pour une eau potable propre , Agroscope Communiqués pour médias, 13.06.2019
- Alena Schmidt, Gabriele Mack, Anke Möhring, Stefan Mann, Nadja El Benni: «Analyse d’impact relative à l’initiative pour une eau potable propre: effets économiques et structurels dans l’agriculture» Agroscope Science Nr. 83, Juni 2019 (Résumé en français, étude en allemand)
- BLW-Chef Lehmann findet Initiativen unethisch, LID.ch, 14.06.2019