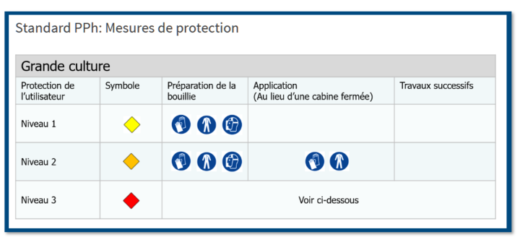Conférence Agroscope 2020: durabilité et protection végétale – des innovations pour l’agriculture
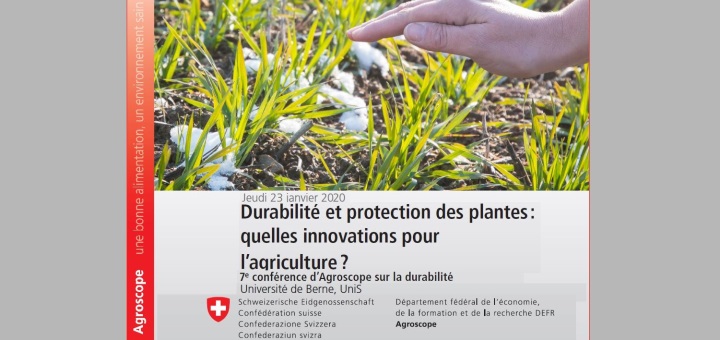
Les exigences concernant la protection des végétaux sont en constante augmentation. L’objectif est de soutenir la production alimentaire locale tout en améliorant le développement durable de l’agriculture. La conférence Agroscope 2020 sur la durabilité a montré des approches innovantes très prometteuses, mais aussi les difficultés liées au développement de méthodes de substitution.
« Dans le domaine de la protection des plantes, l’agriculture est confrontée à d’énormes défis », a souligné Eva Reinhard, directrice d’Agroscope, en ouverture de la 7ème conférence sur le développement durable, qui s’est tenue le 23 janvier 2020 devant plus de 200 personnes dans un amphithéâtre de l’Université de Berne plein à craquer. En réalité, de 30 à 60 % des rendements dépendent des efforts des agriculteurs pour lutter contre les parasites, les maladies et les mauvaises herbes. Sous l’influence du changement climatique et de la mondialisation, de nouveaux organismes à problèmes apparaissent. Le nombre de produits phytosanitaires autorisés diminue et les solutions de rechange font parfois défaut. La société attend d’une agriculture aussi naturelle que possible des aliments de haute qualité obtenus sans pesticides.
Satisfaire à cette demande réclame un gros effort scientifique et beaucoup d’innovations dans différents domaines : tests de produits de substitution aux phytosanitaires chimiques, sélection de variétés végétales plus résistantes, améliorations des techniques d’application des phytosanitaires. Le perfectionnement des systèmes de prévision et le recours aux outils numériques dans l’agriculture de précision revêtent aussi une grande importance. Dans treize présentations, des chercheurs, agronomes et spécialistes des maladies, des parasites, des sols et des plantes d’Agroscope, des organisations partenaires, des hautes écoles et de l’industrie ont montré tout à tour comment la recherche financée par le domaine public et le privé relève ces défis et de quelles solutions alternatives et complémentaires l’on dispose face aux pesticides.
Alain Gaume, responsable chez Agroscope du domaine stratégique de recherche «Protection des végétaux», s’exprime sur l’avenir de la protection des végétaux
Urs Niggeli, directeur de l’institut FiBL, a introduit la conférence en présentant un aperçu de la « Protection des plantes dans les systèmes de culture agroécologiques ». Ces dernières années, l’agriculture mondiale est certes parvenue à augmenter les rendements pour répondre aux besoins alimentaires croissants de la population de la planète. Mais cet effort a entraîné une surexploitation des ressources disponibles et n’est donc pas soutenable à long terme. Les systèmes de culture biologiques et agroécologiques pourraient être utilisés pour concilier l’offre et les besoins de ressources, mais leur productivité réduite exigerait des adaptations drastiques. Parmi ces dernières, citons entre autres une forte réduction de la production de fourrages pour animaux et donc de la consommation de viande au profit de la production de cultures vivrières, ainsi qu’une réduction très sensible des pertes alimentaires. De plus, les systèmes agricoles devraient être revus en profondeur et orientés bien plus résolument vers la prévention, de telle sorte que les pesticides ne soient utilisés qu’en tout dernier recours. Il faudrait aussi procéder à une gestion ciblée des habitats en vue de tirer parti de la biodiversité pour lutter contre les parasites. Selon Urs Niggeli, le financement de la recherche devrait s’orienter davantage vers le développement de systèmes complexes.
Le premier bloc de présentations a porté sur les innovations dans la protection des cultures. Katia Gindro et Sylvain Schnee, d’Agroscope, ont décrit divers axes de recherche ciblant des alternatives aux fongicides conventionnels, qui sont suivis depuis plus de dix ans déjà. Il s’agit d’isoler de nombreux principes actifs de la nature, par exemple des extraits de champignons ou de plantes, pour observer leurs effets. Un exemple prometteur est l’extrait de sarment de vigne, dont l’efficacité est en constant développement depuis des années, bien que divers obstacles techniques (notamment la photosensibilité de la substance active) doivent encore être surmontés avant qu’il puisse être utilisé en viticulture. Une molécule naturelle développée par Biorem a également donné de bons résultats lors d’essais sur le terrain, bien que la frontière étroite entre efficacité et nocivité pour les végétaux doive encore être optimisée.
Giselher Grabenweger, d’Agroscope, a décrit les possibilités fascinantes qu’offrent les champignons insecticides pour lutter contre les insectes nuisibles. Un certain nombre de solutions pratiques existent déjà dans ce domaine, mais en matière de recherche, les besoins restent considérables pour mettre en valeur le grand potentiel de cette approche dans la lutte contre d’autres ravageurs. Matthias Brandl, responsable R&D Biologie chez Syngenta, a présenté la vision d’une entreprise engagée dans la recherche pour la protection végétale du futur. L’utilisation de semences améliorées et les applications et solutions numériques innovantes, combinées aux nouveaux produits de protection des cultures, garantiront les rendements et amélioreront la durabilité. Les produits biologiques, tels que des principes actifs d’origine végétale et des micro-organismes, jouent à cet égard un rôle tout particulier. D’intenses activités de recherche sont prévues pour élargir le portefeuille de ces substances actives et le marché devrait connaître une croissance significative dans un avenir proche. Ce point de vue est partagé par Martin Günter, CEO d’Andermatt Biocontrol Suisse, qui dirige l’une des entreprises pionnières de la protection biologique des cultures. Avec l’utilisation d’insectes bénéfiques, de virus contre les insectes nuisibles, de nématodes contre les parasites du sol et de techniques de confusion hormonale dans la culture des fruits et de la vigne, l’entreprise accompagne un développement constant vers une protection des cultures de plus en plus biologique.
Ali Asaff Torres, directeur de la R&D d’Innovak SA, a montré comment l’administration simultanée de micro-organismes bénéfiques et de substances ayant un impact positif sur la qualité des sols peut améliorer la santé des végétaux, le rendement et la qualité des récoltes. Le bloc de présentations suivant était consacré au cheminement allant de l’innovation à l’autorisation. Jürgen Kohl, Biointeractions and Plant Health, WUR Wageningen, s’est étendu sur les opportunités et les défis de la coopération entre les institutions publiques de recherche et les entreprises privées. Souvent la recherche fondamentale trouve des approches prometteuses et novatrices en matière de protection phytosanitaire, mais qui ne tiennent pas compte des problèmes potentiels d’application pratique (par exemple des coûts) lors de leur développement. En pareil cas, une coopération étroite avec les entreprises tout au long du développement peut permettre d’éviter des erreurs coûteuses en temps et en argent. Min Hahn, de la section Biotechnologie de l’OFEV, a signalé que les méthodes alternatives ou biologiques de lutte contre les parasites peuvent également avoir des effets néfastes sur l’environnement. Comme pour les produits phytosanitaires classiques, les autorités d’admission doivent donc clarifier ces risques sérieusement et en profondeur, conformément au principe de précaution, avant d’agréer une demande.
Sur le thème de la gestion des sols et des mauvaises herbes, Marcel van der Eijden, d’Agroscope, a décrit l’influence majeure des micro-organismes du sol sur la croissance et le bien-être des cultures. Exercer une influence ciblée sur la composition des espèces d’organismes du sol, par exemple grâce à l’ajout ciblé de micro-organismes bénéfiques, peut réduire les besoins d’engrais et de produits phytosanitaires. L’effet de ces traitements est toutefois très variable et de nombreuses recherches sont nécessaires pour s’assurer qu’ils peuvent être utilisés de façon régulière et fiable.
Le dernier volet thématique portait sur la gestion des risques, la robotisation et l’efficience économique. Pierre-Henri Dubuis, d’Agroscope, a présenté la plateforme de prévision Agrometeo. Celle-ci permet de prévoir la propagation des maladies et des ravageurs sur la base des données météorologiques actuelles, en tenant compte de la situation d’infestation présente, puis de formuler ainsi des recommandations spécifiques pour l’utilisation ciblée de mesures phytosanitaires. « Véhicules et drones autonomes pour la protection des cultures » : tel était le sujet développé par Thomas Anken, d’Agroscope. Divers systèmes sont déjà disponibles pour la lutte contre les mauvaises herbes, comme les robots de terrain à pilotage autonome qui identifient les mauvaises herbes à l’aide de caméras et les détruisent de manière ciblée. Les solutions de lutte contre les parasites en sont encore à leurs débuts, car les organismes (par exemple les insectes, les escargots) sont plus difficiles à repérer et sont mobiles. Les approches pour le confinement technologique des maladies sont les moins avancées, car la détection fiable par des systèmes de caméras et des capteurs est très exigeante. Enfin Alexander Zorn, d’Agroscope, a présenté un rapport sur la « viabilité économique et l’acceptation de mesures alternatives de protection des cultures », car lorsque les agriculteurs décident d’utiliser de nouvelles méthodes, ces facteurs jouent naturellement un rôle décisif.
Dans son exposé de clôture de la conférence, Alain Gaume, responsable du domaine stratégique de recherche « Protection des végétaux » chez Agroscope, a résumé une nouvelle fois les grands défis auxquels l’agriculture est confrontée. Il a souligné qu’en raison de l’évolution des conditions-cadre, la protection phytosanitaire devient de plus en plus exigeante et que pour de nombreuses cultures, des solutions efficaces font de plus en plus défaut. Voilà pourquoi, a-t-il insisté, des innovations s’imposent de toute urgence dans de nombreux domaines – du développement de nouveaux produits phytosanitaires à l’organisation de systèmes agricoles plus efficaces et mieux intégrés, en passant par des techniques d’application ciblées et des variétés végétales plus robustes. En coopération avec des partenaires, d’autres organismes de recherche et avec l’industrie, Agroscope contribue grandement à la réalisation de cet objectif.
Compléments d’informations sous: